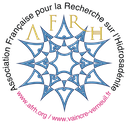écouter
Evaluation de l’efficacité des traitements
Les difficultés thérapeutiques résultent des incertitudes pathogéniques. L’évaluation de l’efficacité des traitements est difficile dans cette affection où les études contrôlées sont rares, les séries souvent peu nombreuses et où aucun médicament n’a l’AMM (Autorisation de Mise sur le Marché) pour cette indication précise. C'est pourquoi il est important que les médecins apprennent à utiliser les possibilités offertes par le Plan Maladies rares comme :
l'article 56 de la loi de finance de la sécurité sociale pour 2007 qui permettent une prise en charge dérogatoire par l'assurance maladie de toute spécialité, tout produit ou prestation prescrits en dehors du périmètre des biens et des services remboursables (c'est-à-dire normalement non pris en charge), pour le traitement des maladies rares.
...
Ce plan prend notamment en compte les aspects médico-sociaux des maladies chroniques.
..."
l'article 56 de la loi de finance de la sécurité sociale pour 2007 qui permettent une prise en charge dérogatoire par l'assurance maladie de toute spécialité, tout produit ou prestation prescrits en dehors du périmètre des biens et des services remboursables (c'est-à-dire normalement non pris en charge), pour le traitement des maladies rares. La possibilité pour les patients de pouvoir également bénéficier des dispositions du plan "Qualité de vie des patients atteints de maladie chronique".
... Ce plan prend notamment en compte les aspects médico-sociaux des maladies chroniques.
TRAITEMENT
MÉDICAL
Il faut éviter les phénomènes de macération par une hygiène
stricte, un séchage soigneux des plis et le port de
sous-vêtements peu serrés, en coton. Les longs trajets en
voiture, surtout l’été, la position assise prolongée
sans mobilisation ne sont pas recommandés.
Même s’il n’existe pas de différence
significative entre le poids moyen d’un groupe de
patientes atteintes de maladie de Verneuil et un groupe
témoin, on conseillera un régime chez les obèses.
TRAITEMENTS
ANTI-INFECTIEUX
On pensait auparavant que le mécanisme primitif des poussées inflammatoires de la
maladie de Verneuil n'était pas d’origine
infectieuse, et que donc ni l’antisepsie ni
l’antibiothérapie ne pouvaient prétendre guérir cette
affection. Or, on observait toutefois des surinfections dues à
des germes variés : Streptococcus milleri, Staphylococcus
aureus ou S. epidermidis, à Gram négatif.
Les travaux d'une équipe française sont cependant en train de révolutionner cette idée. Je vous engage donc à visionner le film ci-dessous et lire que les résumés des récentes publications qui présentent ces travaux ainsi que leurs conclusions :
- Efficacité de l’ertapénème (1g/j) en traitement d’attaque dans l’hidrosadénite supputée sévère
- Microbiologie de l’hidrosadénite suppurée : une étude sur 102 lésions
Antiseptiques
Ils sont appliqués, éventuellement dilués ou
en solution aqueuse moins irritante, après un nettoyage
soigneux à l’eau et au savon et un rinçage abondant
pour éliminer toute trace de pus de la surface cutanée. On
utilise l’hexamidine, la chlorhexidine ou les dérivés
iodés. Leur efficacité est modérée et transitoire.
Antibiothérapie Locale
· La clindamycine topique à 1 p. 100 (Dalacine T Topic®) a
été utilisée avec succès sur le nombre de nodules,
d’abcès et de pustules dans une étude contrôlée. Les
effets secondaires sont minimes : sensation de brûlure dans
quelques cas. Si la pénétration cutanée existe, le risque
de colite pseudo- membraneuse est très bas.
· Elle est débutée rapidement en cas de surinfection,
adaptée aux résultats de l’antibiogramme. En phase
chronique, le prélèvement bactériologique des lésions
fermées, abcès et sinus, est difficile car elles sont
souvent très profondes. Par ailleurs, le rôle pathogène
d’une bactérie retrouvée dans une lésion fistulisée
est douteux, de sorte que
la culture avec antibiogramme n’est pas
indispensable.
Antibiothérapie Générale
L’efficacité de ce topique a été confirmée par une
étude comparant deux applications quotidiennes de
clindamycine à 1 p. 100 et 1 g de tétracycline per os. Les
deux traitements sont également actifs sur la régression
des nodules après un délai d’au moins trois mois [4].
Les antibiotiques les plus utilisés sont les cyclines. Du
fait des accidents graves rapportés avec la minocycline, on
utilisera de préférence la doxycycline, à la dose de 50 à
200 mg/j, ou la tétracycline à la dose de 1 g/j.
En cas de grossesse, on choisira l’érythromycine à la
dose de 1 g/j ou 500 mg/j (Égéry®) La prise avant le repas
assure les meilleurs taux sériques.
Les Rétinoïdes
Des succès thérapeutiques ponctuels ont été rapportés
d’abord avec l’étrétinate, qui n’est plus
commercialisé, et l’acitrétine, probablement en
raison de l’action de ces rétinoïdes sur
l’hyperkératinisation.
C’est l’isotrétinoïne (Roaccutane®) qui est la
plus utilisée. La principale cible étant la glande sébacée,
le rôle mineur de celle-ci dans la pathogénie de la maladie
de Verneuil explique les résultats très décevants de ce
traitement.
Après l’enthousiasme des premières publications, ce
traitement ne doit plus être prescrit dans le cas
d’une Maladie de Verneuil.
TRAITEMENTS
ENDOCRINIENS
La prépondérance féminine, les modifications de la maladie
de Verneuil pendant la grossesse ou lors des règles, la
rareté de son installation avant la puberté ou après la
ménopause suggèrent l’intervention de facteurs
hormonaux. Cependant, les résultats concernant
l’hyperandrogénie, qu’elle soit biologique ou
clinique, sont discordants.
Des traitements anti-androgènes ont été administrés avec
succès chez la femme dans des études ouvertes ou
contrôlées, avec des schémas variés.
Acétate de Cyprotérone
Une étude croisée en double insu chez 18 patientes [6] a
conclu à une nette amélioration sans différence
significative entre les deux groupes traités, pour
l’un avec 50 mg/j d’acétate de cyprotérone du
5e au 14e jour du cycle et 50 μg
d’éthinylœstradiol du 5e au 25e jour du cycle,
et pour l’autre avec 50 μg
d’éthinylœstradiol et 500 μg de norgestrel.
Les meilleurs résultats seraient obtenus avec
l’association de 100 mg/j d’acétate de
cyprotérone 20 j/mois et de 50 μg
d’éthinylœstradiol.
Finastéride
Ce médicament, inhibiteur sélectif de la 5a-réductase de
type 2, n’a l’AMM que pour l’adénome
prostatique à la dose de 5 mg/j (Proscar®) et
l’alopécie androgénétique à la dose de 1 mg/j
(Propecia®). Il est interdit chez la femme en raison du
risque d’anomalie de développement de
l’appareil génital chez le fœtus de sexe
masculin.
Partant de l’hypothèse que la glande apocrine
contient de la 5a-réductase, des auteurs ont essayé le
Proscar® chez deux sujets avec une forme sévère de maladie
de Verneuil. Ce traitement a été efficace après un mois
chez un homme de 56 ans, et 3 mois chez une femme
ménopausée. Des études complémentaires sont nécessaires
pour évaluer l’activité de ce médicament [2].
TRAITEMENTS
ANTI-INFLAMMATOIRES
Selon les travaux dComme pour toute maladie infectieuse, ils doivent être totalement arrêtés en raison du risque d'extension de l'infection. En cas de douleurs on orientera le malade vers des classes thérapeutiques
LES ANTI TNF-alpha (Tumor Necrosis Factor)
L'inhibition du TNFα par un anticorps monoclonal, comme l'infliximab (Remicade®) ou l'adalimumab (Humira®), ou une protéine chimérisée avec le récepteur soluble au TNF, comme l'etanercept (Enbrel®), fait partie de l'arsenal thérapeutique actuellement disponible dans de nombreuses maladies auto-immunes.
En inhibant le TNFα, ces drogues inhibent la réponse inflammatoire qui est la cause principale des manifestations cliniques de ces pathologies auto-immunes. Des essais cliniques quant à l'efficacité de ces drogues sur la Maladie de Verneuil sont en cours.
Ces traitements peuvent augmenter le risque de contracter la tuberculose, ou la réactivation d'infections latentes.
L'infliximab et l'adalimumab, ainsi que l'etanercept, ayant tous reçu l'approbation du FDA, stipulent l'existence de ces risques sur leur notice d'emploi, recommandant une évaluation du risque de tuberculose latente, le traitement devant être reporté après la trithérapie antituberculeuse le cas échéant.
Le TNF, ou ses effets, peuvent également être inhibés par certains composés naturels, dont la curcumine (présente dans la curcuma) et les catéchines (présentes dans le thé vert).
TRAITEMENT CHIRURGICAL
C’est la solution pour
les formes graves et résistantes au traitement médical.
TECHNIQUES
CHIRURGICALES
L’extériorisation des abcès et des fistules suivie de
cicatrisation dirigée « à ciel ouvert » est une méthode
moins délabrante, parfois choisie dans les formes moyennes.
La conservation du plancher des lésions permet une
réépidermisation rapide, mais ne met pas à l’abri des
récidives précoces.
L’excision par laser CO2 sous anesthésie locale, avec
vaporisation par couches successives, est une technique
rapide, avec des suites simples et de bons résultats
esthétiques après 4 à 8 semaines de cicatrisation dirigée.
Un avantage par rapport à la chirurgie classique est
l’hémostase qui permet une meilleure visualisation du
champ opératoire [3].
MÉTHODES DE
CICATRISATION ET DE RECOUVREMENT DES LÉSIONS
La fermeture directe est rarement possible après une
chirurgie radicale. Une plastie en Z est indispensable dans
l’aisselle. Les récidives surviennent dans un quart
des cas.
La cicatrisation dirigée est obtenue dans des délais de 2 à
5 mois selon l’importance de la perte de substance et
nécessite des pansements réguliers, mal acceptés par les
patients.
Les greffes de peau mince ou en filet pour des surfaces
plus étendues permettent un recouvrement rarement immédiat,
généralement différé de 15 jours, de la plaie opératoire en
un ou plusieurs temps, avec des résultats esthétiques
diversement appréciés. Cette technique évite les brides
rétractiles des plis.
Pour la région axillaire, on peut utiliser un lambeau
musculo-cutané du muscle grand dorsal pour combler la perte
de substance lorsque l’exérèse est étendue à la zone
pileuse et à la marge de sécurité. Il n’y a alors
aucune récidive [8]. La région sacrée peut faire
l’objet du même type de chirurgie.
RÉSULTATS ET COMPLICATIONS
Dans une série de 82 patients, 91 p. 100 des patients sont
satisfaits de l’intervention mais la chirurgie
n’empêche pas le développement de l’affection
dans d’autres zones.
Sur une série de 106 cas d’exérèses larges [7], le
taux de complications est de 17,8 p. 100, la plupart étant
mineures : lâchage de suture, saignement, hématome. La
surinfection survient dans 3,7 p. 100 des plaies. On a
également rapporté des brides rétractiles, surtout
axillaires, des sténoses et des incontinences anales.
La fréquence des récidives locales après une chirurgie
radicale est de 2,5 p. 100, sans relation avec la méthode
chirurgicale de reconstruction mais corrélée à la gravité
de la maladie de Verneuil. Elles s’observent plus
volontiers dans les régions mamelonnaire et
inguino-périnéale. Elles peuvent faire l’objet
d’excision localisée.
STRATEGIE
THERAPEUTIQUE
L’évolution de la maladie de Verneuil est
imprévisible. Les possibilités thérapeutiques étant
réduites, la prise en charge psychologique ne doit pas être
négligée. Il est licite de tenter plusieurs traitements
médicaux, malgré l’absence d’AMM et les
résultats contradictoires de la littérature, avant de
recourir à un geste chirurgical large.
Dans tous les cas, mais surtout chez les obèses, les règles
d’hygiène et de diététique et les antiseptiques
locaux sont nécessaires.
En cas de maladie de Verneuil débutante, à faible nombre
d’éléments ou peu étendue, on prescrira :
– dans les formes inflammatoires, clindamycine
locale, antibiothérapie générale par les cyclines ou
l’érythromycine, poursuivie pendant 6 à 12
mois si la réponse est positive après 3 mois. En cas de
douleur importante et d’impotence fonctionnelle, on
peut inciser et
drainer un abcès fluctuant.
. des traitements chirurgicaux conservateurs :
excision-suture.
- dans les formes rebelles aux traitements médicaux ou plus
étendues, ou sévères d’emblée avec formation de
fistules et de sinus, ou tardives avec gangue scléreuse, il
n’y a pas d’autre alternative que le traitement
chirurgical confié à un spécialiste en chirurgie plastique
ou digestive, habitué à cette pathologie. Il choisira sa
technique opératoire, excision large chirurgicale ou par
laser CO2, en fonction de ses habitudes et de l’état
général du malade qui peut contre-indiquer une anesthésie
générale.
Les techniques de recouvrement d’emblée par greffe ou
lambeau seront privilégiées chez les malades actifs car
réclamant une immobilisation courte.
L’antibiothérapie générale est utile en période
préopératoire pour réduire les phénomènes inflammatoires et
infectieux.
En fonction de la localisation : l’exérèse-suture
sous anesthésie locale, à éviter sur la région sacrée, est
réservée aux lésions limitées des plis génitaux ou
axillaires.
L’excision-greffe est adaptée aux lésions étendues
mais superficielles avec, de préférence, une greffe en
filet sur les régions génitales au relief tourmenté.
La plastie par lambeau musculo-cutané est réservée aux
localisations axillaires ou sacrées et aux exérèses très
profondes mettant à nu des structures vasculaires.
CONCLUSION
La maladie de Verneuil est une maladie d’évolution
imprévisible. Si certaines formes sont peu invalidantes,
d’autres, au contraire, retentissent fortement sur la
qualité de vie des sujets atteints. On doit essayer les
traitements médicaux, dont certains sont encore en cours
d’évaluation, car ils sont parfois efficaces, avant
de recourir à un geste chirurgical, sauf en cas de
forme très évolutive où celui-ci sera proposé
d’emblée.
Bibliographie
1. BOER J, VAN GEMERT MJP. Long-term results
of isotretinoin in the treatment of 68 patients with
hidradenitis suppurativa. J Am Acad Dermatol, 1999, 40 :
73-76.
2. FARRELL AM, RANDALL VA, VAFAEE T, DAWBER RPR.
Finasteride as a therapy for hidradenitis suppurativa. Br J
Dermatol, 1999, 141 : 1138-1139.
3. FINLEY EM, RATZ JL. Treatment of hidradenitis
suppurativa with carbon dioxide laser excision and
second-intention healing. J Am Acad Dermatol, 1996, 34 :
465-469.
4. JEMEC GB, WENDELBOE P. Topical clindamycin versus
systemic tetracycline in the treatment of hidradenitis
suppurativa. J Am Acad Dermatol, 1998, 39 : 971-974.
5. LAMFICHEKH N, DUPOND AS, DESTRUMELLE N et al. Traitement
chirurgical de la maladie de Verneuil : 15 cas. Ann
Dermatol Vénéréol, 2001, 128 : 127-129.
6. MORTIMER PS, DAWBER RP, GALES MA, MOORE RA. A
double-blind controlled cross-over trial of cyproterone
acetate in females with hidradenitis suppurativa. Br J
Dermatol, 1986, 115 : 263-268.
7. ROMPEL R, PETRES J. Long-term results of wide surgical
excision in 106 patients with hidradenitis suppurativa.
Dermatol Surg, 2000, 26 :638-643.
8. SOLDIN MG, TULLEY P, KAPLAN H et al. Chronic axillary
hidradenitis : the efficacity of wide excision and flap
coverage. Br J Plast Surg, 2000, 53 : 434-436.